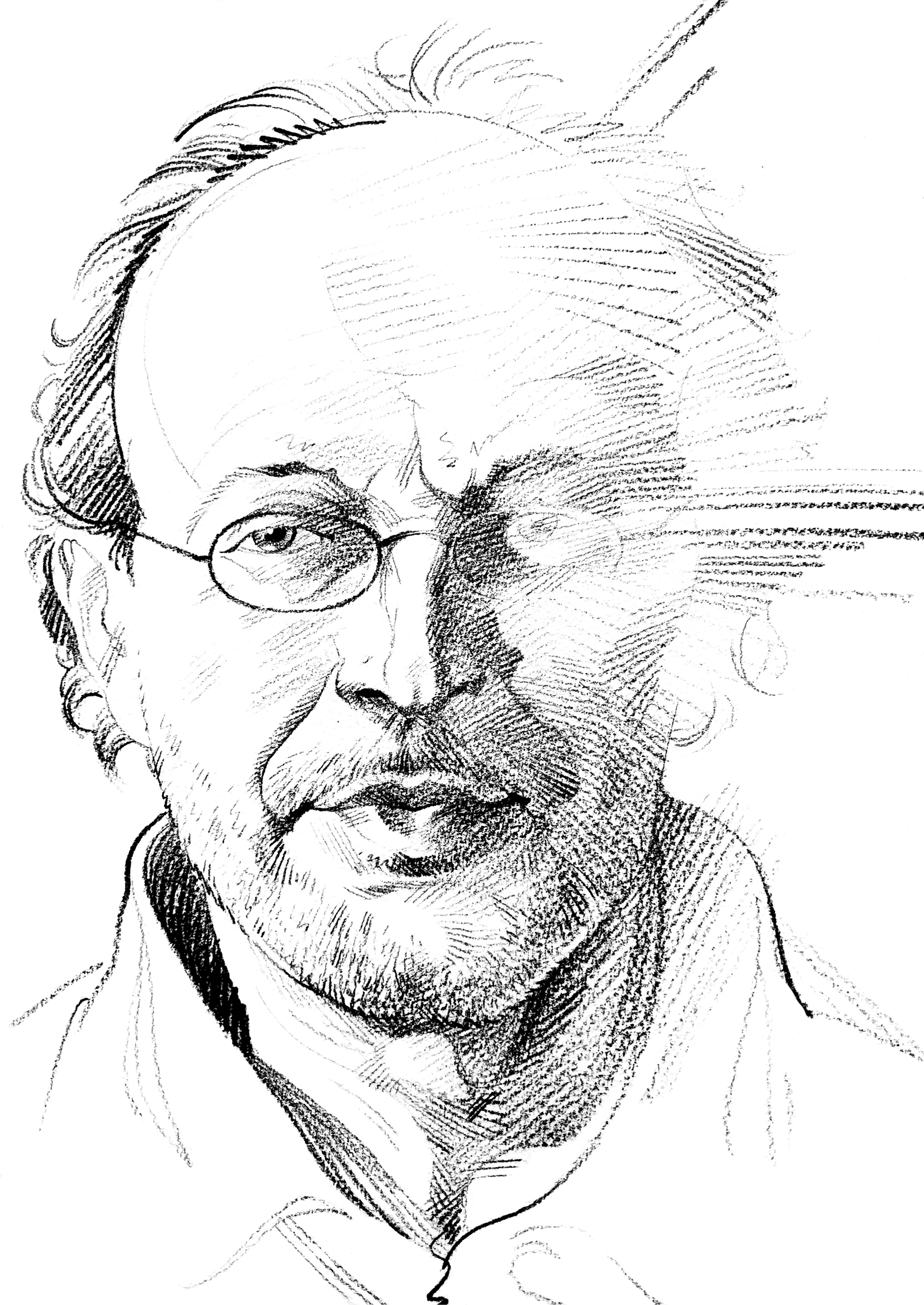Depuis deux siècles, les revues littéraires accompagnent le mouvement de la création, l’observent, la commentent, parfois la devancent. Témoins et éclaireurs, elles saisissent l’état d’une époque, ses tensions, ses manières singulières d’habiter le langage. À son tour, Littératures & Cetera s’inscrit dans cette tradition de veille et de transmission. Quatre fois l’an, elle proposera des entretiens approfondis avec des écrivains, des chroniques sur la création littéraire et artistique, des textes inédits, des études d’ensemble, des redécouvertes d’auteurs oubliés ou négligés, ainsi que des réflexions critiques sur le sens et les enjeux de l’écriture. Plus qu’une tribune, elle se veut un espace où la littérature se discute, se confronte, se renouvelle, se contredit et se prolonge sans jamais s’enfermer dans des certitudes.
Car écrire n’est jamais neutre : c’est répondre à une voix ancienne, anticiper celle d’un lecteur à venir, dialoguer avec les morts, parler aux vivants. C’est essayer de transformer l’émotion en forme, l’instant en phrase, l’expérience en signe durable. Lire, à son tour, revient à se mesurer à cette voix, trouver dans les mots une manière de mieux habiter le monde.
Littératures & Cetera aspire à être tout à la fois miroir et passeur : miroir de la diversité littéraire contemporaine, passeur entre les générations, reliant auteurs et lecteurs dans la conviction profonde que les livres ne se contentent pas d’éclairer d’autres livres, mais traversent et éclairent aussi nos vies.
***
Le roman historique, né au carrefour de l’imaginaire et de la mémoire, conjugue la rigueur de l’histoire et la liberté de la fiction. Il offre aux écrivains, et aux lecteurs, un espace privilégié pour interroger le passé autant que le présent. Inauguré au xixe siècle par Walter Scott, qui en fixa les premiers modèles avec Waverley, et poursuivi par Victor Hugo, Alexandre Dumas, Patrick Rambaud, Pierre Lemaitre, Amin Maalouf et beaucoup d’autres, le genre n’a cessé de se réinventer, traversant les époques pour mieux en explorer les complexités et les résonances.
Le roman historique ne se réduit ni à la seule évocation du passé ni à une pure invention : il aspire à faire revivre des époques révolues en leur conférant sens, chair et voix, saisissant la part secrète des destinées collectives et individuelles. Structurellement, il repose sur une double exigence : l’exactitude du cadre — faits, lieux, costumes, mentalités — et l’élan créatif qui offre aux archives la respiration du vécu. Cette tension entre savoir et invention irrigue la vitalité du genre : la fiction dialogue sans cesse avec l’Histoire et interroge la fabrique des mémoires.
Les auteurs contemporains s’emparent de sujets à la fois universels et singuliers : migrations, luttes pour la liberté, bouleversements identitaires, crises sociales et expériences intimes, croisant souvent histoire collective et perspective individuelle. Ce dialogue incessant entre hier et aujourd’hui fait du genre un miroir inquiet et fascinant de nos sociétés, qui peut aussi bien révéler les cicatrices d’autrefois que questionner notre rapport au présent. Aujourd’hui, à travers la diversité de ses thèmes, le roman historique donne à voir la singularité des vies anonymes, la complexité des grandes crises et permet, parfois, d’interroger l’histoire du point de vue des oubliés, des vaincus, ouvrant ainsi de nouveaux horizons critiques.
Ce dossier invite à s’interroger, en tant que lecteur, sur ce que nous cherchons dans la reconstitution du passé : une clé pour comprendre le présent, un laboratoire du récit, une autre manière d’habiter le temps. Ce numéro ouvre ces pistes sans les refermer et laisse à chacun la liberté de poursuivre le voyage, porté par le souffle du roman historique et la puissance évocatrice de la fiction.
Ce parcours à travers le roman historique vise ainsi à mettre en lumière la fécondité d’un genre qui, entre archives et invention, mémoire et imaginaire, ne cesse de faire dialoguer le passé et l’avenir.
***
On pourrait croire que la littérature est un long fleuve tranquille, que les grands livres traversent les siècles sans remous, figés dans la mémoire collective, sanctuarisés par l’école et les anthologies. On croit les chefs-d’œuvre gravés dans le marbre, les vérités littéraires acquises. Pourtant, il suffit d’une enquête, d’un témoignage, d’un document exhumé pour troubler ces eaux calmes. Le vernis se fissure, les mythes se renversent, les réputations tremblent. Et ce qui paraissait définitivement acquis se remet à bouger. Deux livres récents, Folcoche d’Émilie Lanez et In violentia veritas de Catherine Girard, incarnent cette onde de choc. Ils revisitent des légendes installées, bousculent des récits fondateurs, et rappellent que la littérature n’est pas un temple du vrai, mais un champ mouvant où se rejouent les drames du mensonge, de la mémoire et du pouvoir symbolique.
À la croisée de la confession et du roman, le roman familial occupe une place singulière dans la littérature moderne. Il naît du besoin d’écrire sur ses origines, de dire les blessures fondatrices, mais aussi de les remodeler, de les mettre en scène, de les dominer. C’est un genre double : à la fois exorcisme et falsification. L’auteur y invente son enfance autant qu’il la raconte, il y règle ses comptes sous couvert de sincérité, et transforme la douleur en œuvre. La frontière entre vérité et invention s’y dissout dans une alchimie troublante : la littérature devient une forme de pouvoir sur la mémoire, un tribunal secret où l’on juge les siens, un espace où le mensonge peut se faire plus convaincant que le vrai.
C’est ce qui se joue dans Vipère au poing d’Hervé Bazin et dans la légende noire véhiculée par Catherine Girard, la fille de Georges Arnaud, l’auteur du Salaire de la peur. Chez le premier, la fiction a tué symboliquement la mère ; chez la seconde, le père retrouve son statut de criminel. Deux faces d’une même médaille : celle de la littérature comme arme de domination sur le réel.
Lorsque Vipère au poing paraît en 1948, le choc est immense. On y découvre Jean Rezeau, alias Brasse-Bouillon, enfant martyr d’une mère dévorante surnommée « Folcoche », contraction de « folle » et « cochonne ». Le roman décrit un univers familial empoisonné, une éducation d’humiliation et de coups, un huis clos d’une cruauté glaçante. Le lecteur y voit un cri de vérité, un témoignage sur l’enfance maltraitée. L’auteur, jeune, rebelle, se pose en victime d’une bourgeoisie corsetée, d’une mère tyrannique, d’un père faible. Le succès est foudroyant. Le livre devient une référence, étudié dans les écoles, adapté au cinéma, cité en exemple pour son réalisme psychologique. Le mot « Folcoche » entre dans la langue courante pour désigner la mère monstrueuse.
Mais voilà que, près de quatre-vingts ans plus tard, une enquête fait vaciller ce mythe. Dans Folcoche (Grasset, 2025), Émilie Lanez revisite l’histoire familiale de Bazin. À partir d’archives, de lettres, de témoignages, elle révèle une tout autre vérité : Paule Hervé-Bazin, la mère de l’écrivain, n’a jamais été cette ogresse qu’on a peinte. Femme réservée, pieuse, maladroite dans l’expression des sentiments, elle fut dévastée par la trahison littéraire de son fils. Lanez exhume surtout une correspondance stupéfiante d’Hervé Bazin à son frère : il y admet que la construction du mythe de Folcoche est délibérée, une manoeuvre rentable destinée à faire scandale, se libérer du joug familial, et lancer sa carrière.
Ce que la critique avait tenu pour une confession devient alors une fiction vengeresse, une manipulation du souvenir au profit d’un destin d’écrivain. Folcoche n’existe pas : elle est un masque littéraire, un monstre inventé pour dissimuler les propres turpitudes de Bazin : vols, escroqueries, internements psychiatriques, condamnations judiciaires et divers épisodes peu glorieux de sa jeunesse. Ce que l’auteur a commis, ce n’est pas un témoignage, mais un meurtre littéraire. La mère, effacée dans la réalité, est exécutée dans le roman, son image salie pour l’éternité.
La révélation d’Émilie Lanez ne diminue pas la puissance du roman ; elle en déplace le sens. Vipère au poing cesse d’être un récit autobiographique pour devenir une étude sur la manipulation du vrai. Bazin, en tuant symboliquement sa mère, invente sa propre légende : celle du fils maudit, de l’enfant révolté. Il transforme sa biographie en mythe. Et le milieu littéraire, de même que les lecteurs, fascinés, se sont laissé berner.
À l’inverse de Bazin, Georges Arnaud (de son vrai nom Henri Girard) ne tue personne par la plume — mais peut-être aurait-il tué. Le 25 octobre 1941, dans le château familial d’Escoire, en Dordogne, son père, sa tante et la domestique sont massacrés à coups de serpe. Henri Girard, unique survivant, est immédiatement accusé. Après dix-neuf mois de prison, un procès retentissant et la plaidoirie magistrale de Maurice Garçon, il est acquitté. L’affaire demeure non élucidée. Le jeune homme, devenu héritier, change de nom et de vie. Il devient Georges Arnaud, écrivain, auteur du Salaire de la peur.
Pendant des décennies, il cultive le mystère, joue de son passé comme d’une légende maudite. Des « aveux » non vérifiés, faits plus tard à des proches ou à l’écrivain Gérard de Villiers, sont tenus comme des provocations ou des mystifications. En 2017, Philippe Jaenada publie La Serpe, magistrale reconstitution de plus de 600 pages, concluant à l’innocence d’Arnaud. L’écrivain y apparaît comme victime d’un acharnement judiciaire et d’un siècle injuste.
Mais voici que le livre de Catherine Girard, In violentia veritas (Grasset, 2025) vient tout bouleverser. Fille de Georges Arnaud, elle raconte le poids du silence, les insultes à l’école, le surnom qu’on lui donnait : « la fille de l’assassin ». Un jour, à quatorze ans, elle lui demande la vérité. Il la regarde, et dit simplement : « Tout est vrai. » L’homme qu’elle admirait aurait donc reconnu le crime. Ce n’est pas un réquisitoire, mais une quête de sens, une libération : Catherine Girard écrit pour comprendre la transmission du silence, les mécanismes de la honte, le poids des secrets dans la filiation. Son livre ne cherche pas la preuve judiciaire, mais la vérité intime, celle d’une fille prisonnière d’un mensonge paternel.
Cette publication déclenche une tempête. Philippe Jaenada s’indigne, parle de « tissu de mensonges », accuse la fille de trahir la mémoire des morts. Mais peu importe que l’aveu soit prouvé ou non : In violentia veritas déplace le centre de gravité du récit. L’affaire d’Escoire n’est plus seulement un mystère judiciaire ; elle devient un drame familial, une tragédie transmise de génération en génération. Là où Arnaud avait voulu effacer le crime par la fiction, sa fille le ressuscite par le livre.
Hervé Bazin et Georges Arnaud semblent opposés : l’un invente un crime qu’il n’a pas commis ; l’autre dissimule peut-être un crime réel. Pourtant, leurs trajectoires se rejoignent dans un même usage de la littérature : maîtriser le récit avant que d’autres ne le racontent. Chez l’un comme chez l’autre, l’écriture devient une forme de contrôle sur la mémoire. Écrire, c’est dominer le passé, c’est imposer sa version du vrai.
Le roman familial, dans sa puissance cathartique, est aussi une arme à double tranchant. Il prétend guérir, mais il contamine ; il libère, mais il détruit. Bazin tue sa mère pour se construire ; Arnaud se tait pour survivre. Et dans les deux cas, la littérature façonne une légende qui finit par éclipser la réalité. Ce pouvoir de la fiction — son aptitude à modeler les perceptions, à faire du faux un souvenir collectif — constitue sa force la plus fascinante et sa dangerosité la plus redoutable.
Les révélations d’Émilie Lanez et de Catherine Girard rappellent qu’il existe une littérature du contre-feu. L’une enquête, l’autre témoigne. L’une redonne voix à la mère effacée, l’autre éprouve le besoin de révéler. Ces livres rétablissent l’équilibre rompu, réinscrivent la vérité — ou prétendue comme telle — là où la fiction avait tout recouvert. Ils prouvent aussi que la littérature, loin d’être mensonge, peut redevenir acte de justice, non au sens juridique, mais moral et symbolique. Dans ces contre-récits, la fiction ne disparaît pas : elle se transforme en outil critique, en instrument de dévoilement. Ce que les écrivains avaient camouflé derrière les masques de leurs personnages, les nouvelles générations le ramènent à la lumière. Les mythes familiaux, si puissants soient-ils, ne sont jamais à l’abri d’une relecture.
Au fond, la littérature n’est ni le miroir du réel, ni son contraire. Elle est un espace d’expérimentation du vrai. Entre invention et aveu, elle explore ce qui, dans la mémoire humaine, résiste à la preuve. Le roman familial, en particulier, révèle à quel point la vérité intime est toujours une construction : elle oscille entre la sincérité et la mise en scène, entre le souvenir et la vengeance. Ce que les affaires Bazin et Arnaud montrent, c’est la permanence de cette tension : la littérature ment pour mieux dire le vrai. Mais lorsqu’elle outrepasse cette fonction, lorsqu’elle mutile la mémoire des vivants ou maquille la faute, elle devient une arme. Écrire, c’est alors risquer de tuer symboliquement. Et lire, c’est accepter de douter.
Sous l’apparente tranquillité de la littérature, il y a un champ de ruines. Les chefs-d’œuvre, parfois, reposent sur des mensonges. Mais ces mensonges, lorsqu’ils sont démasqués, redonnent paradoxalement vie au texte. Car c’est dans le vacillement du vrai que la littérature, toujours, se régénère.
La littérature, loin d’être le miroir fidèle du vécu, façonne ses propres mythes pour ensuite les déconstruire, revisitant sans cesse la frontière trouble entre la vérité et la fiction.