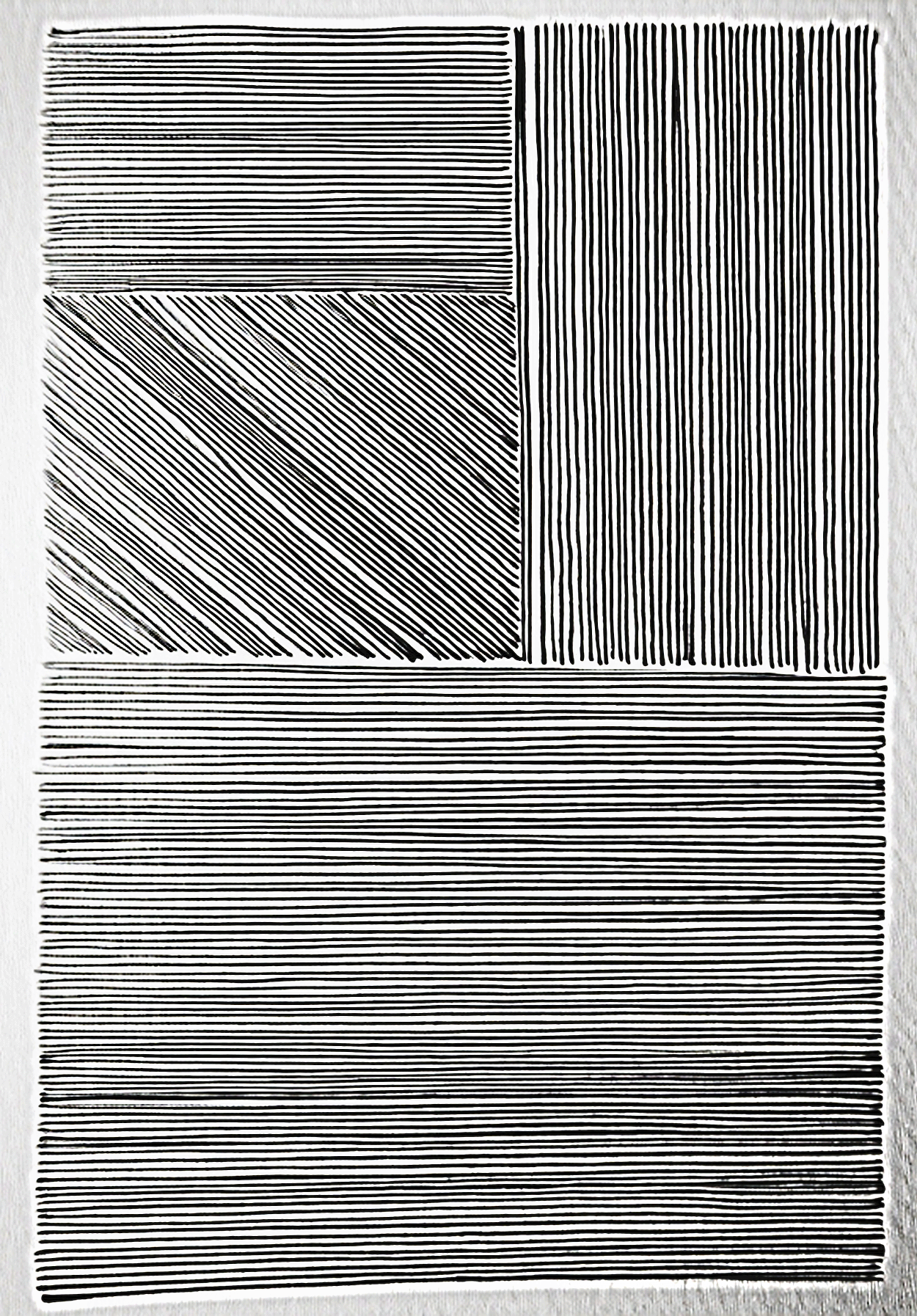Nous avons, me semble-t-il, plus que jamais du mal à nous situer. Nous ne savons plus où nous allons, ni même où nous en sommes. Nous, j’entends les peuples comme les individus, en Occident plus qu’ailleurs. Sans doute la difficulté que nous avons à gérer et digérer le flot d’informations déversé sans hiérarchie aucune y est-elle pour beaucoup. Si bien que pour espérer ne pas être totalement perdus, nous sommes comme condamnés à analyser les symptômes qui nous accablent. Pour preuve, nous avons de plus en plus de peine à définir correctement, sans que cela crée des vagues d’incompréhension et de haine, nombre de notions : l’individu, le citoyen, la nation, la culture, la démocratie, les sexes, l’amour et j’en passe. « Malaise dans la civilisation », dirait le père Freud. Plus que cela. Nous pourrions avec profit relire le dernier paragraphe de cet essai paru en 1930, nous rappeler aussi qu’il établit que « nous vivons pour être heureux », et que cette aspiration suppose de notre part un effort, je dirais une « opposition » à toutes les puissances susceptibles de nous en priver. Il existe donc en ce monde des entités qui font obstacle à toute possibilité de fin heureuse et le bonheur reste un idéal que le monde et, plus particulièrement, la civilisation nous refusent, en soumettant à des restrictions notre condition naturelle. Julien Camus écrit judicieusement, dans son intervention au séminaire « Formalisme moral et éthique existentielle » (2011) : « Freud nous conduit dans une impasse, en affirmant que ce que nous avons coutume de penser comme la solution de nos maux, à savoir notre civilisation, se trouve être en réalité le vecteur de souffrances nouvelles et difficiles à assumer. Adhérer à son processus et nous plier à ses diverses exigences implique plusieurs restrictions de notre condition naturelle. L’“Éros” et le “Thanatos” (pulsions de vie et de mort) étant ses premières cibles, la civilisation les inhibe au moyen de commandements qui lui permettent de prolonger son propre développement. Non seulement elle réduit la diversité de notre vie psychique à quelques standards lui correspondant ; elle troque par la même occasion la menace d’un malheur externe hypothétique, à savoir la perte de l’amour de l’autre en tant qu’il se plie volontairement aux conceptions morales imposées par la société, contre une souffrance interne et continue qui se traduit par une tension de “la conscience coupable”. […] Que l’on conçoive comme un bien les restrictions des deux sources de souffrance que sont notre corps et le monde extérieur n’empêche en rien les violences que nous impose la civilisation. Non seulement elle fait de l’autre notre ennemi potentiel si l’on ne reconnaît pas son autorité, mais nous place dans une position d’accablement constant. » Tout renoncement pulsionnel imposé par la civilisation génère une tendance à l’agressivité ; après l’institution de sa propre morale, ces renoncements forment l’occasion de retourner cette agressivité contre nous-mêmes via l’émergence du sentiment de culpabilité. Ce n’est pas sans raison que Freud résume sa pensée en citant un quatrain de Goethe, tiré des Chansons du harpiste, dans Wilhelm Meister :
« Vous nous faites entrer dans cette vie,
Laissez le malheureux devenir coupable
Et vous l’abandonnez ensuite à ses tourments,
Car chaque faute sur terre s’expie. »
Pour pessimiste (certains diraient « réaliste ») que soit cette conception, elle ne l’est pas moins que d’autres, très « classiques », comme celle de l’État de Hobbes dans la partie I de son Léviathan, pour ne citer que lui, et que certaines œuvres maîtresses illustreront à merveille, en littérature comme en philosophie, de Kafka, dans La colonie pénitentiaire (1919) ou Le Procès (1925), à Hannah Arendt, notamment dans Le système totalitaire (1951), ou encore Todorov, dans Mémoire du mal, Tentation du bien (2000), à titre indicatif. Or, l’état présent du « malaise » est, me semble-t-il, accru par la difficulté où nous sommes enfermés de définir correctement la civilisation elle-même, jusqu’à l’idée de « culture ». Et je repense soudain à Kant affirmant que « l’intelligence d’un individu se mesure à la quantité d’incertitudes qu’il est capable de supporter ». Peut-être que ce tsunami d’incertitudes a fini par nous rendre idiots, avant de nous faire sombrer dans une dépression sans issue. L’origine de cette souffrance qui charrie bien entendu une culpabilité endémique est sans doute identifiable, pour partie, dans la thèse de Michel Foucault exposée dans Les Mots et les Choses (1966). Avant d’y revenir, s’ajoutent à cette pensée de la « rupture », selon le terme de l’auteur, d’autres fractures. En premier lieu, le lent effondrement de la « raison psychanalytique » classique, ou si l’on préfère de la grille analytique freudienne comme celle de ses successeurs, dont Lacan au premier chef — et pour conséquence majeure à mon sens, visible et tangible, l’érosion même du discours amoureux, son impossibilité, du rapport à autrui, de l’érotique, voire de la difficulté de penser l’autre et le rapport à l’autre autrement que sous un angle utilitariste. À ce constat s’ajoute le primat de l’immanence, sensible dans la chute du sentiment religieux, par la désaffection des sociétés dites « modernes occidentales » pour le christianisme, et vaguement remplacé par une « morale laïque d’État » qui évacue le fait religieux et son histoire, sa culture, au nom de « valeurs », c’est-à-dire d’un système de références morales fondé sur l’athéisme triomphant et, dans le pire des cas, par des fondamentalismes religieux qui se pensent comme des planches de salut… Le discrédit sera amplifié par Deleuze (dès L’Anti-Œdipe, en 1972, avec force nuances) puis Onfray (dans Le Crépuscule d’une idole, 2010), qui théoriseront les ravages de l’« imposture » psychanalytique (le second adjoindra un athéisme radical à sa nouvelle éthique), sans oublier évidemment l’« apport » de Jacques Derrida, notamment dans Qu’est-ce que la déconstruction ? (1992) — bien que la notion apparaisse dès 1967 dans De la grammatologie. Certes, il emprunte le mot à Heidegger qui, dans Être et Temps (1927), utilise deux termes pour désigner le processus visant à critiquer la théologie et la métaphysique, afin de « réveiller la question du sens de l’être et de son oubli » : Destruktion et Abbau. Le premier contient l’idée de « dé-sédimentation », geste ou attitude visant à se « réapproprier » une expérience originelle de l’être supposément occultée ; le second signifie tout à la fois « démontage » et « démantèlement ». Pour Derrida, la déconstruction est un acte, sinon un événement, voire un imprévisible devenu travail de la pensée inconsciente (au sens freudien, à noter que Freud, lui, parle de « dissociation ») : « ça se déconstruit » sous nos yeux — « ça », c’est le monde, l’époque — et on ne peut que constater sans pouvoir empêcher l’événement de se produire. La déconstruction est donc d’abord ce processus visant à analyser « les structures sédimentées qui forment l’élément discursif, la discursivité philosophique dans laquelle nous pensons ».
Revenons un instant à Foucault qui permet de mieux comprendre l’épais brouillard où nous errons depuis des décennies. Les Mots et les Choses établit qu’il existe un certain nombre de conditions de vérité et que celles-ci « conditionnent » ce qu’il est possible et « acceptable » de dire. Ces conditions sont dites « conditions du discours » ou « épistémé », et attestent des transformations des sciences. Ainsi, la transformation est sensible dans le langage, où la grammaire générale devient linguistique, dans celle de la vie, où l’histoire naturelle devient biologie, dans la « science » de l’accroissement des richesses devenue économie moderne. Pour Foucault, il s’agit de sortir d’une pensée de l’histoire et de souligner « l’écart, les distances, les oppositions, les différences ». Hiatus et abîme… L’épistémé, « c’est un champ ouvert et sans doute indéfiniment descriptible de relations ». Il est donc question d’un « statut du discours » : l’objet est ce qu’en dit celui qui en parle. L’épistémé est à la fois l’objet et le résultat d’une élaboration conceptuelle où l’archéologie remplace l’Histoire dans son sens classique. Il devient par là même non seulement le penseur de la discontinuité historique, mais celui de la rupture. En la matière, il revient aux intellectuels français de la seconde moitié du xxe siècle d’avoir activement travaillé à brouiller tous les rapports classiques au monde, en favorisant non seulement ce que j’appelle la culture des écarts, des failles, des ruptures, mais aussi les traditions, en décentrant les axes de pensée pour privilégier au fond la fin des anciens modes de pensée, le clivage, les oppositions (de classes, de milieux, de cultures…). Parmi ces penseurs éminemment révolutionnaires, il est certain de Pierre Bourdieu joue, lui aussi, un rôle de premier plan. Dans De la distinction (1979), il établit que « l’individu social est un agent mû par intérêt, personnel ou collectif (son groupe, sa famille), dans un cadre élaboré par l’habitus qui est le sien », et surtout, sa contribution majeure est de poser que « la capacité des agents en position de domination à imposer leurs productions culturelles et symboliques joue un rôle essentiel dans la reproduction des rapports sociaux de domination ». Je ne rentrerai pas dans les subtilités d’une définition de l’habitus selon Bourdieu, tel n’est pas mon propos, ni à sa conception de l’« illusio », ou de l’impact du « pouvoir de violence symbolique » exposé dans La Reproduction sur le mode de fonctionnement du système d’éducation. Il m’importe de souligner que penser le pouvoir revient à penser la violence plus que l’ordre, la discrimination plus que l’homogénéité du corps social, le clivage plus que la volonté d’unir et non d’unifier ; exercer un pouvoir est nécessairement exercer une oppression (à des degrés divers en intensité, évidemment), tenter de poser (et d’imposer) une pensée consensuelle de violence d’État acceptée par la totalité du corps social, etc. Monde orwellien. Exercer un pouvoir suppose toujours une forme de domination, et donc de contrainte. Esclavage volontaire, dirait La Boétie. Bien qu’il faille ici dissocier la dépendance consentie du rapport amoureux… Encore faut-il comprendre aussi ce que cela suppose : une cohésion, un accord de la totalité de ceux sur qui ce pouvoir (politique) est opéré. Il suppose également une adhésion aux lois et aux principes fondateurs de l’Institution elle-même ainsi qu’à ses corolaires, dont l’un des plus dérangeants est sans doute la censure qui, même si elle est officiellement exclue, revient d’une façon ou d’une autre, comme pour mieux protéger le fonctionnement même de la démocratie. Peut-il exister un pouvoir sans censure ? Sans volonté d’exclure, de condamner ? Est-ce un idéal ou une idée directrice jusque-là absente de la réalité des sociétés contemporaines, fussent-elles démocratiques ? Peut-on échapper à la tentation de proclamer : « Pas de liberté pour les ennemis de la liberté » ? La trop célèbre phrase de Saint-Just illustre à quel point un possible glissement vers le pire, selon une logique d’une redoutable cohérence, risque toujours de ruiner les plus belles aspirations… Les dérives de la Révolution française établissaient une tyrannie plus réelle que celle supposée de l’Ancien Régime. À la Déclaration des droits de l’homme répond la Terreur, comme un prolongement quasi logique, compensateur : il était tellement « impossible » de penser réellement la liberté, ou plutôt l’idée qu’on s’en faisait, qu’il paraissait « légitime » d’éliminer ceux qu’on soupçonnait de la mettre en péril ! Nous avons donc « inventé » cela, des droits immarcescibles assortis du droit de tuer, d’éliminer toute opposition, et même s’il faut être fou, comme Clemenceau, pour penser que la Révolution est un « bloc », il serait de loin préférable de regretter que de si beaux principes finissent dans un bain de sang. Pas d’idéal sans répression ? Hélas, sans doute. Du moins, pas de régime qui échappe peu ou prou à l’exercice d’une censure. Elle peut être sournoise, convoquer le respect des grands principes démocratiques qu’il faut protéger de toute atteinte, de corruption, elle n’en est pas moins effective. Et, à l’heure de l’information en direct et en continu, elle peut compter sur les médias pour asseoir son pouvoir, autant que sur l’opinion devenue « tribunal de la rue ».
Alors même que nous mettons tout et n’importe quoi dans une possible définition de la démocratie, alors qu’elle est le pouvoir du peuple par le peuple pour le peuple (via ou non ses représentants), je m’étonne que nous ayons plus encore de mal à comprendre qu’il ne peut y avoir de démocratie sans liberté absolue d’expression. Et chaque fois que, de près ou de loin, elle est remise en cause (c’est-à-dire sans arrêt), je repense à la phrase de Simone Weil : « La liberté d’expression est un besoin de l’intelligence, et par conséquent de l’âme humaine. La liberté d’expression totale, illimitée, pour toute opinion, quelle qu’elle soit, sans restriction ni réserve, est un besoin absolu de l’intelligence. Si l’intelligence est mise à mal, c’est l’âme entière qui souffre. » (Tiré de L’Enracinement, 1949.) Voilà qui dérange. Parce que le pouvoir de la bêtise est hélas plus dictatorial que celui de l’intelligence, et surtout plus généralisé. Or, nous avons beau lutter pour le maintien sans exclusive de ce fondement, il est sans cesse remis en cause et bafoué. Certes, cela ne date pas d’hier.
Amor viarum flexuosarum, dirait saint Augustin, « amour des chemins aux longs détours », peut-être, oui. J’ai cru bon d’établir une esquisse de généalogie du « malaise », de trouver quelques origines à la difficulté présente de définir sans ambiguïtés, de remarquer que l’action conjuguée de philosophies disons récentes avait infusé dans les esprits, les mentalités, au point de rendre plus que périlleuse la volonté de dire les choses telles qu’elles sont, non sans regretter que notre temps ait exclu le sens de la nuance. Sans négliger non plus de désigner la présence au sein de l’idée de démocratie de la tentation de censurer tout ce qui serait susceptible de lui nuire. Censure. Condamnation. J’ai beau me convaincre que chaque système politique contient en lui les causes de sa décadence et de sa fin, je déplore que le recours à la censure soit celle qui précipitera l’anéantissement même de la démocratie. Alors, bien sûr, être réellement démocrate c’est souffrir, puisqu’il faut non seulement respecter le choix de l’opinion majoritaire, la politique de l’adversaire, mais plus encore sans que le débat, l’opposition s’acharnent à la discréditer, la ridiculiser : argument contre argument, sans exclusive, il n’y a pas d’autre chemin. Mais pour ce faire, encore faut-il que les mots aient un sens et qu’on puisse s’accorder sur leur emploi. Étonnant, pour ne pas dire affolant, qu’il y ait aujourd’hui des organes implicites de propagande qui ne justifient leur existence qu’en condamnant l’usage de toute propagande. En fait, ce qui ne pense pas comme lesdits organes (médiatiques) est insupportable et surtout génère jalousie primaire, envie et peur. Il m’arrive de craindre que le pluralisme nécessaire au fonctionnement de toute démocratie ne se résume demain qu’à une guerre des propagandes, mot désuet (fort employé par les régimes totalitaires comme par l’Église…) qui recouvre une triste réalité. Les conflits inter-médiatiques révèlent des oppositions politiques irréconciliables. Mais jamais aucune d’entre elles ne peut pour autant valider l’usage d’une censure. Hier des autodafés, aujourd’hui des mises au ban, des quarantaines, des anathèmes, relayés avec force sondages pour dire la validation de l’opinion.
Et parfois, du jour au lendemain, la condamnation tombe, ou plutôt la sentence. La récente cabale contre Sylvain Tesson, pour ne citer que lui, en est un exemple lamentable. Pourquoi lui ? Auteur à succès, baroudeur, doué, cultivé, styliste, inclassable, amateur de grands espaces et porté à la vie contemplative autant qu’à l’aventure, il a contre lui d’être apprécié par un lectorat aussi ample que fidèle. Que lui reprochent les signataires de la pétition visant à l’évincer de sa place de parrain du Printemps des poètes édition 2024 ? Il est de droite ! Entendez, cet affreux réactionnaire ne peut en aucun cas présider une manifestation culturelle majoritairement composée de poètes inconnus de gauche… J’avoue avoir quelques difficultés à comprendre les motivations d’un tel acharnement, sans trop savoir ce qu’il faut exactement faire et dire pour être sans l’ombre d’un doute classé dans la catégorie des hommes de gauche ou de droite. Si l’on en croit Deleuze, « être de gauche c’est d’abord penser le monde, puis son pays, puis ses proches, puis soi ; être de droite c’est l’inverse ». Question donc de hiérarchie : du monde à soi. Comme j’ai mauvais esprit, je ne peux m’empêcher de citer Foucauld, dont l’invective « Et d’où tu parles, toi ? » est devenue un classique. « Je parle depuis moi. Toujours. Hélas. Et depuis mon milieu aussi, effectivement. Depuis une certaine culture. De tout ce qui fait mon moi, ma personne, ma singularité… » Comment penser le monde autrement qu’à partir de soi ? Faute de le laisser penser par autrui… Cette définition au demeurant séduisante et poétique ne recouvre au fond pas grand-chose. À l’époque où Deleuze écrit cette définition, le paysage politique est sans doute moins brumeux qu’il ne l’est aujourd’hui. Il n’a pas connu les joies rhétoriques du « en même temps », alors que nous sommes depuis lors bien en peine pour définir clairement et en fonction de quels critères ce qu’est réellement un écrivain de droite ou une auteure de gauche. Sauf quand Mme Ernaux défile avec LFI — nous pouvons alors en déduire qu’elle est de gauche, peut-être même de gauche extrême. Pour certains noms du patrimoine littéraire, la chose est encore plus facile : Chateaubriand, de Maistre, Constant, Barbey d’Aurevilly, Taine, Bourget, Bloy, Bernanos, Barrès, Maurras, La Varende, Bainville, Guénon, Rebatet, Céline, Mauriac, d’Ormesson, J. Raspail, Houellebecq… sont de « droite ». Et encore, il faudrait là aussi nuancer, ne pas oublier Brasillach ou Henri Massis, isoler les plumes qui trempent dans la vieille « extrême droite », antiparlementaire, autoritaire, « parti de l’ordre » et compagnie, des patriotes ou nationalistes. Chaque époque applique une grille de lecture aux référents fort différents pour établir le bien-fondé de sa censure.
Cela mérite un petit rappel historique sur l’évolution de ces interdits en France. Le Moyen Âge ne s’offusque de rien, les gaillardises des trouvères et troubadours ne choquent nullement les clercs, et de toute façon le lectorat est tellement restreint que les rares lettrés apprécient l’usage d’une liberté d’expression sans contraintes (pensons au gisant d’Aliénor d’Aquitaine : elle tient un livre ouvert en main, tellement la lecture était alors exceptionnelle). La mise en place d’une réglementation de l’imprimerie au xvie siècle, par l’obtention d’un « privilège », ne laisse pas pour autant la porte ouverte à une administration de censeurs avides de tout interdire ; ne sont privées d’octroi (ou mises en demeure d’être corrigées) que les œuvres portant ouvertement atteintes à la royauté et à l’Église, lesquelles fonctionnent de concert. La quasi-totalité des pages les plus gaillardes ne sont pas systématiquement interdites, mais la censure déjà fort active s’en prend à Rabelais : en 1533, la Sorbonne condamne Pantagruel pour obscénité et en 1542, le Parlement le censure en même temps que Gargantua, et Marot, Calvin, Érasme… Histoire de n’oublier personne ! En revanche, la création de l’Index Librorum prohibitorum, consécutive au Concile de Trente, publié sur demande de l’Inquisition par le pape Paul IV en 1559, puis confirmé en 1564, marque une étape décisive. Vingt éditions jusqu’en 1948 et suspension en 1966, qui fixent l’interdiction de posséder, lire, vendre ou diffuser des ouvrages jugés contraires à la doctrine de l’Église, pernicieux, hérétiques, licencieux, subversifs. Très largement diffusées par les autorités ecclésiastiques dans l’ensemble de la catholicité, ces éditions jouent un rôle répressif considérable. Copernic, Montaigne, Descartes, Diderot, Malebranche, Montesquieu, Rousseau, Voltaire, Balzac, le Larousse, mais aussi Machiavel, Kant ou Lamenais en feront les frais. En 1566, la promulgation de l’ordonnance de Moulins impose l’obtention d’une autorisation d’imprimer de la part de la Chancellerie royale, rendue après examen de l’ouvrage. Dans les faits, face à l’essor de l’imprimerie, la chancellerie accorde des permissions tacites, fait montre de tolérance et délivre des permissions simples.
Tout va changer et se précipiter en 1623. Théophile de Viau est traîné en justice (sur l’instigation des jésuites) pour impiété manifeste, puis banni après la parution de son Parnasse satyrique ; conséquence directe de cette triste affaire, un durcissement de la censure qui porte les libraires à suspendre la réédition de nombres d’ouvrages antérieurs. Exception faite de la courte période de la Fronde, une atmosphère de crainte va désormais peser sur la librairie. La morale d’État l’emporte et les rois de France, qui estiment devoir leur trône à Dieu, emboîtent le pas à l’Église et ses directives. Les rares œuvres jugées condamnables circulent sous le manteau et sont imprimées à Amsterdam, Rotterdam, La Haye, Leyde ou Utrecht ; ce sera le cas des œuvres de Descartes comme de celles de Bayle, pour son Dictionnaire historique. La répression culmine avec la condamnation à être brûlé vif en place de Grève de Claude Le Petit, avocat parisien de 23 ans, athée de surcroît, suite à la publication de son Bordel des Muses, « et autres compositions en vers pleines d’impiétés et de blasphèmes, contre l’honneur de Dieu, de la Vierge et de l’Estat » (entendez, la famille royale)… Si le xviiie siècle reste officiellement sous l’emprise de la censure, il est dans les faits plus tolérant, pour exemple la bienveillance de Malesherbes qui permet tacitement la publication de L’Encyclopédie de Diderot et d’Alembert, pourtant officiellement condamnée. Au pire, les livres jugés les plus scandaleux font l’objet d’une saisie, voire de quelques jours d’emprisonnement à la Bastille. N’empêche que les auteurs restent prudents, comme Voltaire ou L. S. Mercier, qui publiera à Londres son essai prophétique sur la démocratie, L’An 2240, après avoir renoncé à le faire imprimer à Toulouse. La Révolution lève les interdits, du moins officiellement, et Sade ne sera pas enfermé à cause de la licence de ses œuvres, dont La Nouvelle Justine, mais à l’instigation de sa belle-mère, alarmée de le voir dissiper ses biens autant que sa réputation. La répression reprend de plus belle après la signature du Concordat en 1802, se renforce sous la Restauration, laquelle impute à des textes comme La Religieuse de Diderot ou Les Liaisons dangereuses de Laclos d’avoir rien moins que participé à l’éclosion de la Révolution. Cette dernière œuvre sera même condamnée à la destruction en 1823 pour ce motif. La monarchie de Juillet recourt à une censure active pour réprimer ses adversaires, et le Second Empire fait montre d’un excès de zèle et de tracasseries peu commun pour se concilier les bonnes grâces d’un clergé en grande partie légitimiste… Flaubert en fait les frais pour Madame Bovary et Baudelaire pour Les Fleurs du Mal : le jugement prononcé en 1857 stipule que ces poèmes « conduisent nécessairement à l’excitation des sens par un réalisme grossier et offensant pour la pudeur ». Ce dont les romanciers et les poètes auront à souffrir est bien entendu étendu aux politiques, à toute forme d’opposition, aux pamphlétaires. Le pouvoir étant abondamment relayé par une presse officielle avide d’obtenir subventions et honneurs. Nombre d’éditeurs, lassés, se replient sur Bruxelles, Genève, Turin ou San Remo. La IIIe République étant d’abord dirigée par des notables (ou des militaires) généralement fidèles à l’une ou l’autre dynastie, la censure ne se relâche aucunement : Isidore Liseux fut par exemple maintes fois condamné pour avoir publié des éditions pourtant confidentielles de l’Arétin, dont les Ragionamenti ; Huysmans et Descaves préfèrent par prudence publier en Belgique. Dès lors, l’enfer des bibliothèques devient le paradis des curieux et amateurs éclairés… Pascal Pia, qui en fut un éminent spécialiste, écrit : « Les pouvoirs publics préfèrent aujourd’hui ne pas diligenter de poursuites contre des livres dont ils peuvent limiter le débit par des mesures administratives prises sans délai, sans débat, et immédiatement exécutoires. » (Préface au Nouveau dictionnaire des œuvres érotiques, 1971.) Certains résistent, contre vents et marées, tel Jean-Jacques Pauvert, qui ne manque pas de citer le jugement d’appel du procès Sade en 1957 : « Le but du décret du 29 juillet 1939 est de protéger la pudeur publique contre l’étalage effronté de la débauche sexuelle, ce qui est l’obscénité, mais encore contre l’expression de la pensée quelle que soit la forme qu’elle revêt lorsque, s’arrogeant toute licence, elle en arrive à enfreindre les règles de la décence et de convenance communément reçues et dont la violation provoque l’indignation collective et la réprobation publique. » Rappelons pour mémoire que la censure avait pourtant officiellement disparu lors de la promulgation de la loi sur la liberté de la presse du 29 juillet 1881, qui confiait au système judiciaire l’essentiel du contrôle des informations publiées sur le territoire — et je ne parle même pas de son rétablissement en temps de guerre, y compris pendant les événements de Mai 68…
À cette censure d’État en succède une autre, insidieuse, rampante et perverse, liée à la tentation de condamner. Sylvain Tesson, pour revenir à lui, a été comme frappé du sceau de l’infamie par une assemblée d’inconnus le qualifiant « d’icône réactionnaire », pour avoir été simplement désigné parrain du Printemps des poètes. Moralité, il reste parrain et son dernier livre, Avec les fées, bénéficiant de ce procès médiatique d’une rare indécence, flirte avec les 90 000 exemplaires vendus en quelques semaines. Quand bien même il serait de droite, je ne vois pas en cela une raison d’élever un bûcher ou de maudire son nom. Ce travers aujourd’hui très en vogue, et qui n’est rien d’autre qu’une censure honteuse, un tribunal d’envieux et d’aigris, en avait déjà disqualifié d’autres ; citons Richard Millet, lui aussi taxé d’écrivain de droite (sinon extrême), et qui perdit, par influence et contagion, sa place d’éditeur chez Gallimard. Les médiocres détestent le talent et Millet est un génie du style, écrivain de premier plan, amoureux de la langue et romancier considérable qui eut le tort de ne pas occulter ses passions littéraires et la veulerie d’un certain milieu des Lettres. Mais la liste est hélas longue de ceux qu’on a voulu faire taire, pour ne pas dire éliminer : La Question d’Henri Alleg (1958), Les Damnés de la terre de Franz Fanon (1961), Suicide mode d’emploi de Claude Guillon et Yves Le Bonniec (1982), L’Os de Dyonisos de Christian Laborde (1987), L’autre visage d’Israël d’I. A. Shamir, sans oublier Le Con d’Irène d’Aragon (1928), évidemment Sade, mais aussi J’irai cracher sur vos tombes de Boris Vian (1946), Lolita de Nabokov (1955), Le Maître et Marguerite de Mikhaïl Boulgakov, Mein Kampf d’Adolf Hitler (1925), mais aussi, dans un tout autre registre, Pilote de guerre de Saint-Exupéry (1942), Thérèse et Isabelle de Violette Leduc (1954), Tropique du Cancer et Sexus d’Henry Miller (1949), Une trop bruyante solitude de Hrabal (1976), Les Versets sataniques de S. Rushdie (1988)… Aujourd’hui, même si la censure d’État n’est plus active, la censure religieuse cantonnée à des fatwas, la menace et les atteintes viennent d’un autre horizon, assez nouveau au demeurant, et qui traduit l’efficience du malaise évoqué, dont les symptômes s’enracinent dans une mutation sociétale profonde, j’ai nommé le wokisme, la cancel culture et ses émules.
Au fond tout procède de la tendance, enracinée de longue date, au « politiquement correct » et à une morale pour le moins pusillanime, dérivé de la pensée unique, de la « bien-pensance », d’une pensée dite de gauche qui peine à admettre et tolérer la moindre différence idéologique, sans oublier une volonté jamais clairement exprimée de revanche et de critique systématique de données civilisationnelles : culture, anthropologie sociale, jugées néfastes, dominatrices, malsaines etc. Une question de pouvoir aussi, et d’inversion des valeurs, comme le mouvement d’un balancier ou le retour d’un boomerang. Tentation (marxiste ou nihiliste) de faire table rase, sinon de brûler la table ! Comme la crise d’hystérie de la Révolution française qui change le calendrier, le nom des villes, invente le culte de l’Être suprême, de nouveaux prénoms, détruit l’ancienne classe dominante, les églises, nettoie la société par la guillotine, les noyades, les massacres… Réaction délirante, viscérale et incontrôlable, au nom de la liberté et surtout de l’égalité — ce fantasme français qui prône l’égalitarisme pour nouvelle religion d’État.
Utilisé pour dénoncer une pratique publicitaire ou des principes de communication qui promeuvent des engagements « de façade », une hypocrisie en somme, le terme s’étend vite à d’autres causes que l’environnement (écologie, cause animale, spécistes…), tels que l’égalité des sexes, les genres, l’inclusion, la défense de microminorités devenues fer de lance de l’âge nouveau, contre civilisation. En somme, il s’agit d’abord d’une lubie groupusculaire, non que les revendications ne soient pas en partie fondées, loin de là, mais elles aspirent à détruire des « perversions » structurelles, comme inhérentes à un vaste groupe humain jugé historiquement dominateur, esclavagiste, raciste, machiste, homophobe et j’en passe ; une « communauté » de culture dont l’identité est le reflet de tous ses penchants, travers et j’en passe, toujours dans le désir (même inconscient) de dominer, soumettre, aliéner. Et tout cela au nom de la justice. Douglas Murray, écrivain conservateur britannique, écrit (dans The Madness of Crowds : Gender, Race and Identity) que le mouvement woke « aggrave les choses en faisant croire aux gens qu’ils sont meilleurs. Beaucoup d’entre nous n’aiment pas l’antagonisation des gays contre les hommes, nous ne voulons pas que les races soient instrumentalisées les unes contre les autres », mais aussi que des communautés minoritaires espèrent rectifier des attitudes historiques simplement pas la condamnation et surtout la haine, le clivage, l’opposition et la violence. Le mâle blanc hétérosexuel serait intrinsèquement mauvais, nécessairement corrompu par des attitudes patriarcales endémiques, pour ne pas dire habité d’intentions sataniques. Mélangez cette haine à l’esprit de revanche d’une certaine gauche bien-pensante, éprise de déconstruction, et vous obtiendrez vite un flot de condamnations, de malédictions, des actions violentes en représailles, des anatbanhèmes, des mises au ban, sorte de mort sociale parfois relayée par des médias complaisants qui craignent de rater le train de l’Histoire…
Sans contextualisation, sans réelle culture historique profonde, aucun consensus n’est possible ; plus encore, je crains que pour commencer à penser réellement la démocratie, il faille être un citoyen cultivé, tolérant, qui possède outre une conscience historique sans cesse remise en cause, une capacité à comprendre l’évolution des sociétés, des mentalités, de façon diachronique, sans faire que les dommages ressentis des uns conditionnent la nécessaire repentance des autres… Le pluralisme ne travaille pas à exclure la diversité d’opinions, mêmes contraires, en revanche je redoute que le malaise s’accroisse sous la volonté de cliver, d’exclure, de contrôler, d’amender, de maudire… Dans ces dérives, je ne vois que l’avancée du règne et du pouvoir de Thanatos, pas celui d’Éros. Il y a hélas bien peu d’amour et de bienveillance dans ces diktats et ces accusations obsessionnelles, moins encore de respect, même pour la personne, que les plus atteints par les pires travers d’hier, entre racisme, sexisme et ségrégation. Étonnant, cette réaction qui consiste à vouloir éradiquer les anciens dominateurs, ou les « déconstruire » afin que leur identité soit comme restaurée pour devenir supportable et correspondre aux nouveaux formats… Nous sommes très loin d’être sortis du malaise qui s’enkyste dans notre civilisation déjà mise en péril par des fondamentalismes de tous bords, et ce n’est certes pas en réactivant les censures de tous ordres que nous verrons Éros revenir féconder une société qui rêve d’être stérile, dissociée, composée de nouvelles « classes » qui, faute de se comprendre ou se supporter, passent leur temps à se haïr… Voilà que se met en place, peut-être durablement, une malédiction venue remplacer une vieille aspiration à la fraternité, je ne vois pas en quoi cela est un progrès.