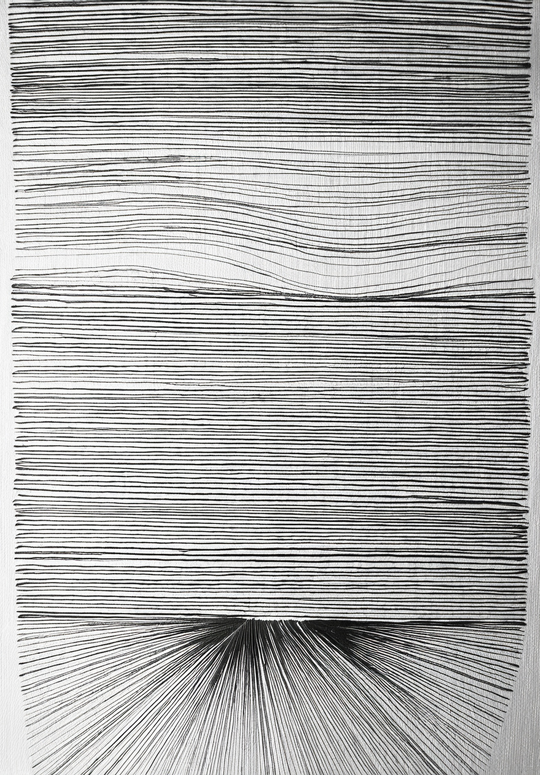Le paradoxe sadien, relevé maintes et maintes fois par Pauvert, se révèle, de jour en jour, de plus en plus pertinent lorsque vient l’heure de se pencher sur les annales judiciaro-littéraires et d’évoquer des auteurs maudits.
Le jeune éditeur Jean-Jacques Pauvert dut lutter jusqu’en 1958 pour que les autorités judiciaires françaises décident de lever le tabou sur l’œuvre du divin marquis. Or, Donatien Alphonse François a poussé les descriptions d’actes de débauche, de crimes sexuels et de tortures à leur paroxysme. Tous les commentateurs s’accordent à ne lui trouver aucun égal tant dans l’horreur des scènes et des sévices que dans l’apparente absence de morale.
Dès lors que Sade est en vente libre, selon Jean-Jacques Pauvert, aucune censure, en tout cas en matière de mœurs, n’a donc plus de raison d’être. Le censeur, s’il était logique — mais, rassurons-nous, c’est sa première vertu, il ne l’est pas —, serait pris au piège de la décision de 1958. Des auteurs maudits, avant 1958 et après, il en existe… L’homme de lettres et avocat que je suis peut en attester. Mais existe-t-il une littérature des écrivains maudits en tant que telle, en particulier en ce début de iiie millénaire ?
Je prendrai pour exemple quelques contemporains, dont j’ai connu la plupart, notamment pour les avoir défendus comme avocat. Car j’ai préfacé un brillant essai du psychanalyste et chercheur Gianpalo Fugliere, début 2023, consacré à des littérateurs des deux derniers siècles, qui m’a permis de revenir sur le caractère protéiforme de la malédiction. Certains romanciers sont devenus des parias, d’autres étaient déjà damnés par leurs contemporains.
L’influence de la réprobation sociale, voire de la censure, complique le jeu des références et des allusions. Des homosexuels célèbres, dont la vie affective était notoire, l’ont parfois très peu évoquée dans leurs écrits. Des hétérosexuels présumés ont laissé dans leur œuvre une trace marquante de leur intérêt pour les rapports amoureux entre individus du même sexe ou encore les ténèbres du crime.
Mais la littérature « maudite », et particulièrement celle la plus proche de nous, est aussi composée de livres d’une qualité littéraire parfois inégale. Toutefois, nombre d’entre eux ont joué un rôle non négligeable par l’originalité de leur traitement de la langue, par l’importance qu’ils ont eue sur plusieurs générations de lecteurs ou par la polémique qu’ils ont engendrée. La littérature contemporaine n’est, de fait, pas épargnée par la censure et continue de disséquer et d’enrichir ce Lagarde et Michard d’un autre genre.
Évoquons quelques noms d’auteurs que j’ai rencontrés et parfois aimés, et de quelques diables devenus ou restés infréquentables.
Nicolas Genka
J’ai passionnément défendu Nicolas Genka, décédé en 2009, sans avoir jamais retrouvé le public qui aurait dû être le sien. Selon le regretté éditeur Raphaël Sorin, Genka était « plus proche d’Artaud que de Sade, voisin de Bataille et de Rimbaud » et « scandaleux », certes, « comme la plupart des mythes, des légendes, des contes ».
En 1961, Nicolas Genka a 24 ans. Il fait paraître aux éditions Julliard (Françoise d’Eaubonne y est son éditrice) son premier roman, écrit à son retour de la guerre d’Algérie et préfacé par Marcel Jouhandeau : L’Épi monstre. Le livre a pour sujet la relation incestueuse d’un père avec ses filles, dont une est mineure. Les critiques littéraires saluent la naissance d’un écrivain, Jean Cocteau lui décerne le prix des Enfants Terribles, et des projets de traduction par Pier Paolo Pasolini, Yukio Mishima et Vladimir Nabokov sont en cours.
Mais, par un arrêté du 6 juillet 1962 prononcé par le ministère de l’Intérieur, le roman est interdit de vente : « Les officiers de police judiciaire pourront saisir les publications exposées » et « arracher, lacérer, recouvrir ou détruire tout matériel de publicité en faveur de ces publications ». C’est la loi du 16 juillet 1949, destinée à protéger les mineurs, qui s’abat sur ce livre écrit pour un public de lettrés adultes. L’interdiction est étendue aux traductions à l’étranger. Dans le même temps, la maison de Genka, en Bretagne, est saccagée, et son beau-frère l’attaque en justice, sous prétexte d’éléments autobiographiques portant à nuire.
Au bout de trente-sept années d’interdiction, les éditions Exils décident de republier l’ouvrage. Cette nouvelle parution ne suscite aucune réaction officielle. Auparavant, Régine Desforges avait formulé une demande auprès du ministère de l’Intérieur : « L’Épi monstre n’est pas un livre pornographique, c’est un texte magnifique […]. L’interdiction de publicité et d’affichage, c’est la mort d’un livre, ça aurait pu être la mort d’un écrivain. »
Devant ce silence des autorités, Nicolas Genka envoie officiellement, via mon entremise, au ministère de l’Intérieur une demande d’abrogation de l’arrêté de 1962 ; mais je ne reçois aucune réponse favorable, ce qui équivaut juridiquement à un rejet de ladite demande : l’interdiction reste donc en vigueur. Le cabinet du ministre (socialiste !) Daniel Vaillant réfute d’ailleurs le terme de « censure », mais considère toujours le livre comme dangereux. Je saisis donc ensuite le nouveau ministre de l’Intérieur, Nicolas Sarkozy, en vain, puis le Conseil d’État pour que la décision du ministre soit annulée.
C’est ainsi que le 27 juin 2005, la levée de la mise en quarantaine (qui dure depuis plus de quarante ans !) est prononcée, car « s’il est constant que l’ouvrage intitulé L’Épi monstre fait une large place à l’évocation de relations incestueuses entre un père et ses filles, il ressort des pièces du dossier que, à la date de la décision attaquée [celle de 2004], en l’absence de circonstances particulières alléguées par le ministre de l’Intérieur, la diffusion de l’ouvrage L’Épi monstre ne présentait pas pour la jeunesse un danger d’une gravité telle que le ministre de l’Intérieur, de la Sécurité intérieure et des Libertés locales pouvait légalement s’abstenir d’abroger l’arrêté du 6 juillet 1962 ». Toutefois, la commissaire du gouvernement relativise cette décision en requérant le maintien d’une interdiction de vente aux mineurs de moins de 18 ans : « L’évolution des mœurs et des mentalités depuis les années 1960 conduit à percevoir sans préjugés les relations libres entre adultes consentants et elle se traduit aussi par une présence dans la presse ou sur les ondes d’images fort différentes de celles que diffusaient les publicités et les films des années 1960 ; elle n’a pas conduit à banaliser l’inceste. Sans doute les images — illustrations ou films — sont-elles plus directement susceptibles d’agresser la conscience d’un enfant qu’un texte écrit, mais vous ne sauriez en déduire qu’aucun texte ne tombe jamais sous le coup de la loi de 1949 sans dénaturer la volonté du législateur. »
Quarante ans pour admettre que la littérature est… de la littérature. Nicolas Genka mourra donc en 2009, quatre ans seulement après la levée d’une interdiction qui l’a rendu muet durant des décennies.
Roger Peyrefitte
Difficile de ne pas mentionner ici Roger Peyrefitte, mort en 2000, et que j’ai rencontré plusieurs fois, notamment à son domicile dans la décennie qui a précédé son décès.
Roger Peyrefitte grandit dans le Sud-Ouest, où il étudie notamment dans deux collèges religieux. Il entre au ministère des Affaires étrangères en 1931, et en est révoqué en 1945. Cette décision, qui sera annulée en 1962, suit la publication de son premier roman, Les Amitiés particulières, en 1944. Il y évoque une histoire d’amour entre deux garçons au sein d’un pensionnat catholique. Georges de Sarre, âgé de 14 ans, est fasciné par la beauté d’Alexandre Mortier, son cadet d’un an et demi, dont il finit par s’assurer l’amitié à la fois chaste et intense. Les adultes chargés de leur éducation tentent de séparer les deux jeunes gens. Le roman fait bien évidemment scandale, mais il est couronné du prix Renaudot. Il gardera une très grande force d’attraction chez des générations successives de jeunes lecteurs.
Secrétaire d’ambassade à Athènes de 1933 à 1938, Roger Peyrefitte est épris de la Grèce, au point de la peindre dans plusieurs livres. L’Oracle (1948) lui permet d’aborder l’archéologie ; La Muse garçonnière (1973) se présente comme une traduction d’épigrammes. Mais c’est surtout en s’attaquant à la vie d’Alexandre le Grand, avec La Jeunesse d’Alexandre (1978), qu’il poursuit dans cette veine. Les amours d’Alexandre et de son entourage y sont clairement évoquées. Il livre également Jeunes Proies, en 1956, puis, en 1967, Notre amour. En 1978, L’Enfant de cœur raconte sa passion de douze années pour un jeune homme pour lequel il se ruine.
En 1976 et 1977, il est contraint de disperser aux enchères sa magnifique collection de livres. Le catalogue est édité en trois volumes, dont l’un est entièrement consacré aux classiques de la littérature érotique des xviie et xviiie siècles. Roger Peyrefitte souligne dans une préface qu’il s’agit là de la première grande bibliothèque secrète à être vendue sous le parrainage affiché du bibliophile qui l’a savamment constituée.
Roger Peyrefitte est enfin un homme de satires plus ou moins nauséabondes, qui s’en prend aussi bien à la diplomatie (Les Ambassades, 1951, suivi de la Fin des ambassades, 1963), à la franc-maçonnerie (Les Fils de la lumière, 1961) qu’à l’Église romaine (Les Clés de Saint-Pierre, 1955) et au judaïsme (Les Juifs, 1965).
Au-delà des dérives politiques de ses dernières années, qui l’amèneront à fréquenter ouvertement l’extrême droite, Roger Peyrefitte reste surtout l’auteur des Amitiés particulières, l’un des ouvrages qui auront le plus compté dans la culture gay pendant plus d’une trentaine d’années. La poésie pudique et candide de Roger Peyrefitte, pétrie d’Antiquité grecque, paraît aujourd’hui appartenir à une vision révolue de l’homosexualité, mais dont il a su alors porter l’héritage avec éclat. Il reste un paradoxe d’auteur maudit, ayant été victime de la réprobation, mais ayant aussi rencontré un vif succès.
Renaud Camus
Je pourrais évoquer ici René Schérer (le philosophe et frère d’Éric Rohmer, que j’ai également défendu), que j’ai édité par deux fois et qui est mort, presque en paria, en 2023. Je suis allé à ses obsèques avec Gabriel Matzneff, dont on ne peut pas dire que le défendre en justice, comme cela m’est arrivé — avec succès, par deux fois, depuis la publication du Consentement de Vanessa Springora —, m’ait valu une grande sympathie publique.
Je vais plutôt me « contenter » du cas de Renaud Camus, un écrivain aujourd’hui connu, hélas, pour sa théorie du « grand remplacement », échafaudée à partir d’un premier « dérapage » datant de l’an 2000.
Renaud Camus avait déjà été l’objet de polémiques d’un autre ordre.
En 1979 paraît son livre Tricks, avec une préface de Roland Barthes, qui rassemble trente-trois courts récits de rencontres sexuelles dans le milieu gay. Le talent dépasse alors le scandale. Puis suivent bien des livres, dont de nombreux volumes de son journal, fidèlement publiés par POL. Jusqu’au tome intitulé La Campagne de France, refusé par Paul Otchakovsky-Laurens, qui paraît chez Fayard, par la grâce du courageux Claude Durand, éditeur de Garcia Marquez et de Soljenitsyne. Las, dans ce tome, ressortent quelques lignes abjectes sur les journalistes juifs de France Culture. Devant le tollé, le livre est retiré de la vente. Il ressortira un mois plus tard dans une version plus acceptable. Entre-temps, Jean-Étienne Cohen-Séat, alors directeur délégué de la branche littérature d’Hachette Livre — à laquelle appartient Fayard — en dit ceci, de très pertinent : « Le livre de Renaud Camus pue. »
Renaud Camus est d’abord envoyé chez mon confrère et ami Henri Leclerc, alors avocat de référence de Fayard, qui caviarde copieusement le livre déjà publié et tance vertement son auteur… Celui-ci en sort rageur, rechignant au verdict implacable de l’ancien président de la Ligue des droits de l’homme.
J’accepte dans la foulée une visite tardive peu agréable, sur la demande insistante de POL qui, malgré tout, ne se sent pas de laisser la situation empirer et m’expédie le fameux Camus. Je prends une bonne heure pour expliquer au diariste, que j’ai croisé des années auparavant sans soupçonner sa dérive, les passages répréhensibles de ses textes, en particulier sur son site internet (un hyperblog littéraire où il développe les notes de bas de pages de son journal et des digressions interminables). Ce pendant numérique de l’ouvrage litigieux est bien pire, et je caviarde la plupart des horreurs illégales qui y persistent, non encore découvertes par la presse. Renaud Camus paraît m’écouter et je ne peux m’empêcher de le remettre à sa place lorsqu’il tente de me convaincre de son bien-fondé. Une fois chez moi, tard dans la nuit, comme convenu, je vérifie, en me connectant à son site, la suppression des pages désignées par mes soins.
J’ai ensuite eu une brève conversation avec Renaud Camlus, mettant fin à son dossier. J’ai tenu Paul (POL) au courant et n’ai pas facturé cette consultation en urgence qui m’avait donné la nausée. Ni Henri ni moi n’avons plus eu de contact avec Renaud Camus. Et le livre est reparu réécrit, tandis que le site restait miraculeusement indemne de tout reproche. Puis cette « affaire Camus » se tassa (mais, hélas ! pas la créature qui s’y était complu), sans procédure aucune.
Lié par le secret professionnel et peu enclin, de toute façon, à faire état de cette clientèle d’un soir, j’ai tu mon intervention. Mais je me suis libéré de ce secret à l’arrivée en librairie d’un nouveau volume du journal, livré à chaud et publié par une officine belge, consacré uniquement à ces péripéties et intitulé Corbeaux. J’y ai lu des contrevérités sur la chronologie et notre double intervention d’avocats. Mais j’ai été presque soulagé de lire, sur près de trois pages, que mon ami Henri Leclerc et moi-même n’avons rien compris à l’écriture. J’y suis d’ailleurs dénoncé comme le « faux ami des écrivains ». Cela m’a valu par la suite quelques messages mi-hilares mi-sympathisants de protagonistes de l’affaire — journalistes et essayistes — qui, eux, ont publiquement bataillé contre cette prose nauséabonde. J’ai souvent fait l’expérience de ces supposés hérauts de la pire idéologie, pétris de liberté d’expression, qui appliquent à la lettre mes consignes de peur du procès, et se vengent en me vouant publiquement aux gémonies.
Le personnage s’est encore plus mué en antisémite à la Maurras (résumons-le ainsi : les juifs ne seraient pas de vrais Français…). Il est devenu une idole de l’extrême droite identitaire, nouant là, sans doute avec un succès de soufre qu’il recherchait, non plus par les mœurs mais, pour notre malheur, par la stigmatisation de nos frères humains.
Un seul exemple judiciaire de ce naufrage en forme de haine constante : le 10 avril 2014, la « chambre de la presse » — la 17e correctionnelle — du Tribunal de grande instance de Paris a condamné Renaud Camus à la suite de propos tenus lors des « Assises internationales sur l’islamisation de nos pays ». Les juges, saisis par une association de lutte contre le racisme, ont examiné les termes de « colonisateurs », de responsables de « vols » et de « rackets dans les écoles », et autres amalgames. Ils ont surtout retenu que « ces propos émanent d’un écrivain se disant particulièrement soucieux du choix des mots qui traduisent exactement sa pensée lorsqu’il s’exprime » ; et de préciser qu’« ils ont fait l’objet d’une lecture lors de la réunion publique incriminée, l’écrivain lisant une allocution qu’il avait auparavant rédigée, ne donnant lieu à aucune improvisation ».
Un professeur de philosophie a été condamné à l’occasion de la même procédure pour des phrases de la même eau que celles du littérateur devenu tribun haineux. Le tribunal a retenu la qualification d’« incitation à la haine raciale ».
Violette Leduc
J’ai toujours été attaché à la figure de Violette Leduc, dont les livres sortent peu à peu d’un long opprobre.
La censure éditoriale — dite « en amont », c’est-à-dire « interne » — n’est pas la moins radicale en matière de charcutage d’œuvre littéraire. Violette Leduc, qui dut la subir à de nombreuses reprises, à la fois par son entourage, son éditeur Gallimard, et même par sa protectrice Simone de Beauvoir, la nommait d’ailleurs la « guillotine cachée ». Les raisons de cette censure ne manquent pas, d’autant que Leduc avait généreusement recours à ce qui est aujourd’hui nommé « autofiction », puisant dans les épisodes de sa propre vie pour écrire. « Pourquoi, lorsque je serai morte, aurait-on envie d’écrire ma biographie ? J’ai passé ma vie à ça », avait-elle confié à une amie.
Quand paraît, en 1955, son roman Ravages, l’écrivaine a 48 ans, deux livres derrière elle et une petite réputation parmi les intellectuels de la capitale. En effet, après une dizaine d’années d’existence spartiate dans des meublés de la banlieue parisienne avec sa compagne, elle deviendra échotière au sein des éditions Plon. Ce travail lui permettra de rencontrer notamment Maurice Sachs, écrivain homosexuel au très sulfureux parcours, dont elle s’éprendra. Suscitant l’admiration de Cocteau, Sartre, Genet, Jouhandeau à la parution, en 1946, de L’Asphyxie dans une collection dirigée par Camus, elle se liera d’amitié avec Nathalie Sarraute.
À la fin de la guerre, elle est présentée à Simone de Beauvoir. C’est cette dernière — à laquelle elle déclarera sa flamme — qui l’encourage à se lancer dans l’écriture de Ravages, dont Carlo Jansiti, auteur de Violette Leduc, biographie, dit qu’« aucune femme écrivain n’est allée aussi loin dans la description de l’homosexualité féminine ». D’ailleurs, Beauvoir s’en inquiète. Elle « corrige » le manuscrit — au point de le « beauvoiriser », disent certains —, ce qui n’empêche pas le comité de lecture de Gallimard de le décréter impubliable, car la prestigieuse maison redoute un procès, un retrait des ventes, un pilonnage, une condamnation et une amende pour outrage aux bonnes mœurs.
Le brûlant épisode évoquant les amours de deux adolescentes (où le personnage de Cécile est Denise Hertgès, qui fut dans la « vraie vie » surveillante de son collège de Douai et son amante, ce qui provoqua leur expulsion de l’établissement) restera totalement inédit jusqu’à la parution, neuf ans après, de La Bâtarde, où Violette Leduc en glissera certaines parties. Le livre, ardemment préfacé par Simone de Beauvoir, connaît un beau succès en librairie — à la suite de quoi Gallimard acceptera de publier une autre partie du texte censuré, sous le titre Thérèse et Isabelle. Violette Leduc avait établi dès 1954 deux versions dactylographiées, revues et corrigées, de cette partie censurée de son roman, ainsi qu’une édition manuscrite hors-commerce du texte en intégralité.
C’est au bout du compte en 2000, soit presque un demi-siècle après, que les éditions Gallimard publieront le texte en totalité, réunissant ainsi fragments dispersés et passages inédits.
Violette Leduc, morte en 1972 d’un cancer, n’aura bien sûr pas la satisfaction de voir cette édition. Notons que, à l’occasion de la parution de son dernier texte à titre posthume, La Chasse à l’amour (1973), Simone de Beauvoir, nommée par l’écrivaine son exécutrice testamentaire, indiquera dans sa préface avoir supprimé « quelques passages qui [lui] ont paru alourdir inutilement son texte » — l’œuvre leducienne aura donc connu jusqu’au bout, et même après, les effets de la « guillotine cachée ».
À garder en mémoire
Certes, le ministère de l’Intérieur a un peu baissé les bras et le bâton qui est au bout. Pour un Nicolas Genka ou un Mathieu Lindon qui le réveillent de temps à autre, la littérature est beaucoup moins qu’hier la préoccupation première de la police… Mais la privatisation de la censure a pris le relais, et des associations, plus ou moins inféodées politiquement, examinent avec soin l’art contemporain, le cinéma et la rentrée littéraire… sans oublier les réseaux sociaux et les pétitions en ligne.
Mieux, le législateur a huilé encore un peu plus l’appareil répressif dont elles se sont emparées. L’instauration d’un nouveau Code pénal, en 1993, a en effet permis d’élargir le spectre du célèbre et vieillissant « outrage aux bonnes mœurs ». On vise désormais le « message à caractère violent ou pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine ». Les définitions de ces notions sont toujours aussi floues, ce qui permet de tout poursuivre et de trier ensuite. Au final, ce sera au juge d’estimer, dans le plus grand arbitraire, ce qui, de cet érotisme des autres, est pour lui pornographique. Pauvert soulignait souvent que l’exercice est encore plus absurde depuis que le marquis de Sade est en poche.
L’article 227-23 du Code pénal, né entièrement de la réforme de 1993, réprime « le fait, en vue de sa diffusion, de fixer, d’enregistrer ou de transmettre l’image d’un mineur lorsque cette image présente un caractère pornographique ». Précisons qu’il s’agit là d’éradiquer les images à caractère pédophile circulant par exemple sur internet et non de l’image au figuré. Déformer le sens juridique du terme « image » pour fustiger les livres est devenu courant, mais relève d’une exégèse aussi ignare que dangereuse. S’en prendre à la littérature, bonne ou mauvaise, est un combat erroné.
Toutefois, la fameuse loi du 16 juillet 1949 fonctionne toujours selon le même principe. Elle concerne en théorie les publications destinées à la jeunesse, mais elle offre aussi la faculté de sanctionner les « publications de toute nature présentant un danger pour la jeunesse en raison de leur caractère licencieux ou pornographique », c’est-à-dire l’ensemble de la littérature « adulte »…